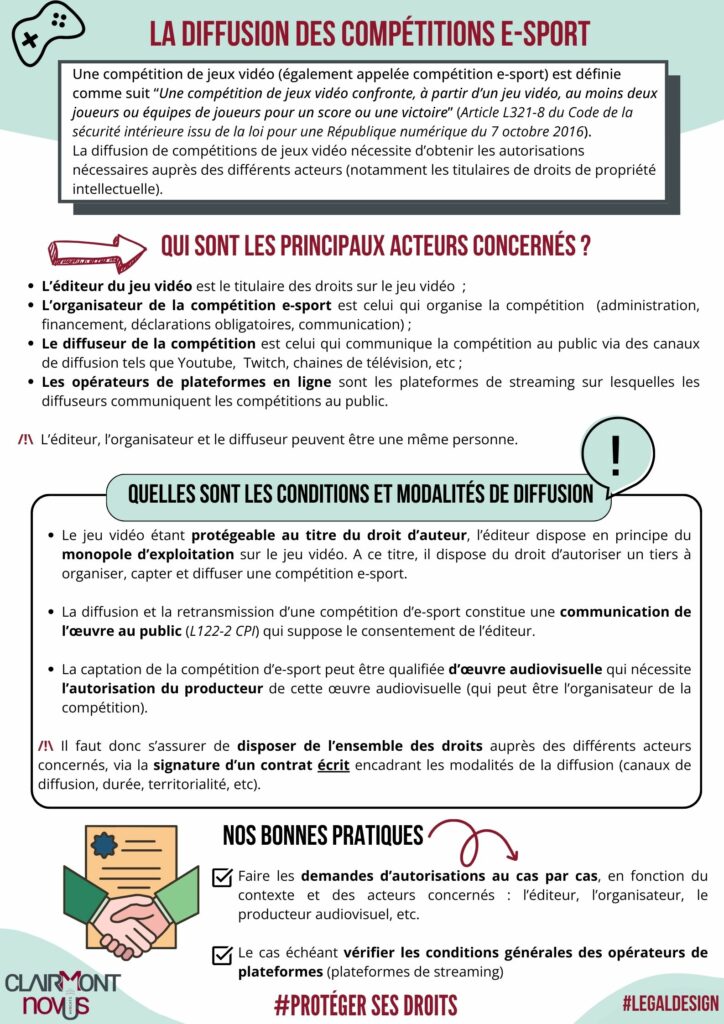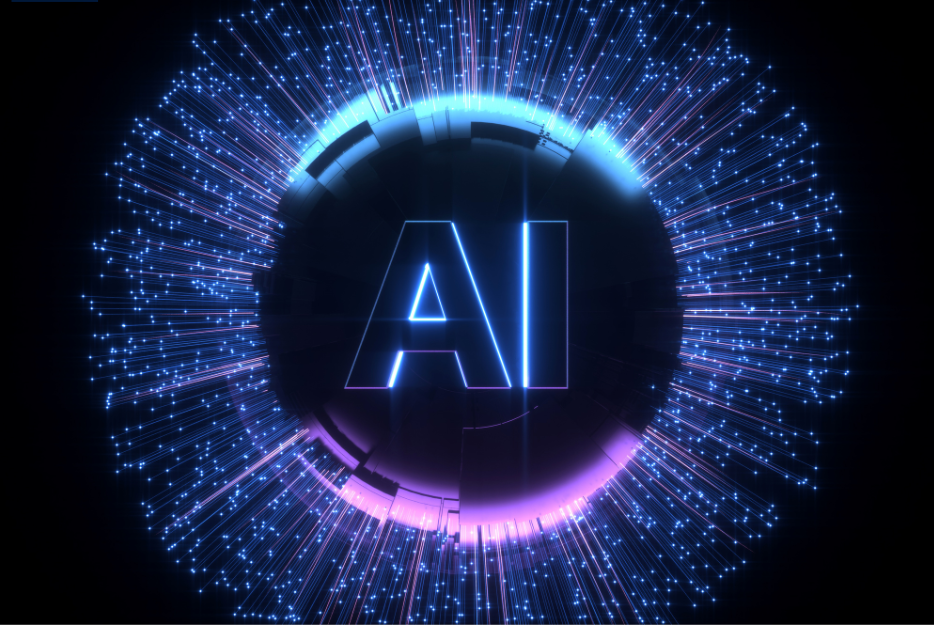Un salarié doit démontrer des choix libres et créatifs dans ses créations pour revendiquer des droits d’auteur.
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2021[1], la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur l’irrecevabilité d’une action en contrefaçon d’un salarié, faute pour celui-ci d’avoir prouvé la titularité de ses droits d’auteur sur les œuvres revendiquées.
Le 15 mai 2013, un salarié a été embauché par la société Comptoir des Cotonniers spécialisée dans le prêt-à-porter, en qualité de styliste pour les accessoires (maroquinerie, chaussures, divers) rattaché à la direction du style. Ce dernier revendique la création en septembre 2014 d’une paire de basket vintage dénommée « Slash » ainsi que sa boîte d’emballage. C’est donc en 2017, que le salarié a mis en demeure la société de lui reconnaître ses droits d’auteur. Face au refus de celle-ci, le salarié l’assigne devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour violation des droits patrimoniaux et moraux attachés à sa qualité d’auteur de la paire et demande par ailleurs la nullité des dépôts des dessins et modèles français effectués par la société.
La société fait valoir qu’il existe une cession implicite des droits d’auteur du salarié à leur égard, ou du moins que la paire de basket est une œuvre de collaboration. Le demandeur, quant à lui, soulève qu’il est le seul styliste pour les accessoires depuis son recrutement, et qu’il aurait été dès lors, à l’origine de cette fameuse paire « Slash ».
Néanmoins, par un jugement rendu le 28 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris ne fait pas droit à la demande du salarié dans la mesure où celui-ci n’apporte pas la preuve de sa titularité des droits d’auteur sur les œuvres revendiquées et le déboute de sa demande de nullité pour dépôt frauduleux des dessins et modèles français. Le demandeur interjette donc appel. La Cour d’appel de Paris confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance.
Tout d’abord, la Cour rappelle qu’en droit d’auteur le principe est que la protection d’une œuvre naît du seul fait de sa création, sans qu’il ait besoin de recourir à des formalités, à condition que celle-ci soit originale, soit empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, c’est à celui qui revendique la titularité des droits d’auteur de rapporter « la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création ». Or, en l’espèce, le salarié ne produit pas des preuves qui permettraient d’établir sa paternité sur les œuvres. En effet, sont seulement versés au débat des dessins faits par le salarié, mais qui ne sont ni signés, ni datés.
En second lieu, la Cour d’appel de Paris précise que l’existence d’un contrat de travail n’est pas de nature à écarter la qualité d’auteur au salarié qui crée dans le cadre de son travail. En d’autres termes, l’œuvre appartient à son créateur, et l’employeur n’est pas titulaire des œuvres créées de manière automatique. Cependant, ce principe n’est vrai que si le salarié a conservé une liberté créatrice dans les choix esthétiques durant tout le processus de création. Or, en l’espèce, il est mentionné dans son contrat de travail que celui-ci est « rattaché à la directrice de style ».
En outre, selon un contrat de service signé en 2014, la responsabilité stylistique et managériale est confiée à la directrice de style. De plus, il est rapporté que de nombreux échanges verbaux et réunions de travail ont eu lieu entre le salarié et la directrice afin d’aboutir à la fabrication du prototype de la paire litigieuse.
Ainsi, si le salarié a effectivement dessiné le croquis de la paire, force est de constater, que celle-ci a été créée sous le contrôle de la directrice de style, de sorte que « l’autonomie créatrice du salarié était restreinte », dans le sens où celui-ci n’a pas pu en définitive exprimer des choix libres et créatifs.
Par conséquent, compte tenu de ces circonstances, la Cour d’appel de Paris considère que le salarié ne prouvant pas sa titularité des droits d’auteurs sur les œuvres précitées est irrecevable à agir en contrefaçon.
Enfin en ce qui concerne les dépôts des dessins et modèles considérés comme frauduleux par le salarié, la Cour d’appel le déboute de sa demande en précisant notamment que ce dernier n’a pas soulevé de réclamation lors de la demande formée par son employeur auprès de l’INPI, alors qu’il en a été associé et en avait été parfaitement informé par des courriels en date du mois de décembre 2014, soit environ deux ans avant l’action du salarié.
A retenir :
- La protection d’une œuvre par le droit d’auteur naît du seul fait de sa création, sans formalité, à condition que celle-ci soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
- C’est à celui qui revendique la titularité des droits d’auteur d’apporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création.
- L’existence d’un contrat de travail n’entraine pas cession implicite des droits d’auteur du salarié envers l’employeur. En effet, la cession des droits d’auteur doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, dans lequel est précisé pour chaque droit cédé son étendu, sa destination, et sa durée.
- L’auteur salarié d’une œuvre doit prouver qu’il a pu exprimer des choix libres et créatifs dans le processus de création.
- Si les choix esthétiques et créatifs d’une œuvre ont été imposés par l’employeur, ou du moins par un supérieur hiérarchique, le salarié ne pourra revendiquer la titularité des droits d’auteur.
[1] CA Paris, pôle 5-2, 5 mars 2021, RG n°19/17254, Comptoir des Cotonniers